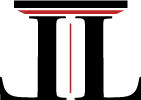Congés payés : le report possible en cas d’arrêt maladie (arrêt du 10 septembre 2025)
Actualité publiée le 13/10/2025
Depuis le 10 septembre 2025, la Cour de cassation permet le report des congés payés coïncidant avec un arrêt maladie, alignement avec le droit européen.
La jurisprudence française en matière de congés payés vient de connaître un tournant majeur en date du 10 septembre 2025. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés peut désormais demander le report des jours non consommés. Cette décision marque une mise en conformité avec le droit de l’Union européenne, qui distingue clairement la finalité des congés payés (repos, détente) de celle de l’arrêt maladie (rétablissement). Cet article s’adresse tant aux salariés qu’aux employeurs, pour leur donner une vision claire des nouvelles règles à appliquer.
Avant d’explorer les modalités pratiques et les précautions à prendre, examinons le fond du revirement jurisprudentiel intervenu le 10 septembre 2025.
Le revirement jurisprudentiel du 10 septembre 2025
La Cour de cassation a profondément modifié sa position traditionnelle sur la coïncidence entre congés payés et arrêt maladie.
Le droit de report désormais reconnu
Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que l’arrêt maladie intervenant pendant les congés n’interrompait pas ces congés : les jours de congé continuaient d’être “consommés”, même si le salarié n’en avait pas pu profiter réellement.
Avec l’arrêt du 10 septembre 2025 (Cass. soc., n° 23‑22.732), la Cour juge désormais que « dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés ».
En d’autres termes, les jours de congé coïncidant avec la période d’arrêt maladie ne peuvent plus être imputés comme “pris”.
Le fondement européen et les raisons du changement
La Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment à travers l’affaire Pereda, selon laquelle un droit au congé non exercé du fait d’une incapacité de travail doit pouvoir être reporté.
L’idée est que le congé payé et l’arrêt maladie ne poursuivent pas la même finalité : le congé payé vise à permettre au salarié de se reposer et de disposer de loisirs, tandis que l’arrêt maladie vise à assurer sa guérison. La France avait été mise en demeure par la Commission européenne, le 18 juin 2025, de garantir cette compatibilité juridique avec le droit de l’Union européenne.
Or ce revirement appelle une adaptation dans les pratiques de gestion des congés, tant pour les salariés que pour les employeurs.
Effets et conditions pratiques du report des jours de congé
Pour transformer ce principe en droit effectif, certaines conditions doivent être remplies.
Notification et justificatif à l’employeur
Pour bénéficier du report, le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur (dans les formes usuelles) et fournir le justificatif médical. Sans cette démarche (notification + justificatif), le droit au report n’est pas déclenché.
Conséquences sur la rémunération et le régime de l’arrêt maladie
Quand les congés sont suspendus à l’occasion de l’arrêt maladie, le salarié bascule dans le régime des indemnités journalières.
Cela signifie que le paiement des congés est interrompu pendant la période de maladie : le salarié sera rémunéré via les indemnités journalières, selon les conditions légales (délai de carence, etc.). Notons que ce report ne permet pas d’« arriver en retard » en reprenant les congés reportés plus tard sans respecter les modalités de planification : s’absenter sans accord constitue une faute.
Malgré ce progrès, certaines zones de doute demeurent en pratique.
Points d’incertitude et limites de la jurisprudence
Voici les principales zones d’ombre à surveiller.
Modalités de fixation du report
L’arrêt de la Cour de cassation n’entre pas dans le détail des modalités du report des jours de congés (délai de report, fixation avec l’employeur, contraintes organisationnelles). Il faudra un accord entre employeur et salarié pour fixer la date de reprise des jours reportés.
Prescription et délai de report
La jurisprudence ne dit pas précisément à quel moment le report doit être exercé, mais il est raisonnable de penser qu’il devra intervenir dans un délai suffisamment rapproché après la reprise du salarié. Le ministère du Travail a, dans un communiqué du 17 septembre 2025, évoqué un délai de quinze mois pour l’utilisation des congés reportés.
Il faudra surveiller la doctrine et les décisions à venir pour confirmer ce délai.
Impact sur les très petites entreprises et les plannings
La mise en œuvre impose une adaptation des pratiques RH, notamment dans les entreprises de taille modeste où les plannings sont déjà serrés. Plusieurs patrons redoutent une surcharge administrative et un coût plus élevé.
L’enjeu est de gérer à la fois les congés planifiés et les éventuels reports imprévus.
Conclusion
En conclusion, l’arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 opère un revirement substantiel : désormais, un salarié tombant malade pendant ses congés payés peut obtenir le report des jours coïncidant avec la période d’arrêt, à condition d’en informer l’employeur. Cette décision marque une convergence du droit français avec les principes de l’Union européenne relatifs au droit au repos.
Toutefois, les modalités pratiques restent à préciser, notamment en ce qui concerne les délais, l’accord de l’employeur, la prescription ou encore l’organisation dans les petites structures. Il conviendra désormais de suivre les textes de mise en œuvre, la doctrine et les décisions judiciaires pour s’assurer d’une application conforme et pragmatique de ce droit nouveau.
Partager